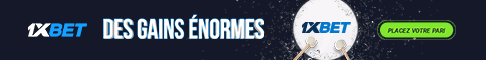En 2022, je publiais un ouvrage de témoignage issu d’une recherche ethnographique menée auprès de jeunes migrants originaires de Guinée, du Mali, du Sénégal et de Sierra Leone. Ce travail visait à documenter, à travers leurs propres récits, les trajectoires migratoires contemporaines depuis l’Afrique de l’Ouest. Loin des analyses macroscopiques souvent véhiculées par les institutions internationales, l’objectif était de restituer la parole des premiers concernés, de comprendre les ressorts individuels et collectifs de la migration.
Trois ans plus tard, les constats demeurent alarmants. En Guinée, comme dans plusieurs pays voisins, les dynamiques migratoires se maintiennent, voire s’intensifient. Cette situation interroge les causes profondes de l’exil des jeunes africains, dans un contexte où les politiques publiques, tant locales qu’internationales, semblent inadaptées.
La permanence des facteurs structurels d’émigration
Les jeunes interrogés évoquent unanimement les mêmes déterminants : absence de gouvernance, chômage massif, précarité généralisée, et inefficacité des structures éducatives et économiques.
L’Afrique de l’Ouest, bien que riche en ressources naturelles, souffre d’une mauvaise gestion chronique. En Guinée, malgré l’exploitation de la bauxite — seconde réserve mondiale —, la jeunesse ne bénéficie d’aucune retombée économique. Le manque d’emplois dignes contraint à envisager la migration comme un passage obligé vers une ascension sociale.
Ce phénomène est renforcé par la « solidarité obligée », où la responsabilité familiale pèse lourdement sur les épaules des migrants, transformant l’exil en devoir plus qu’en projet.
Polygamie, rivalités intrafamiliales et désir d’exil
La polygamie, loin d’être une simple institution matrimoniale, suscite des tensions intrafamiliales. Dans de nombreux cas, les rivalités entre co-épouses et entre enfants issus de différentes unions exacerbent le désir d’émigration.
L’exil devient alors un enjeu de prestige social, une quête d’honneur familial, où la réussite se mesure à la capacité d’envoyer des remittances régulières.
La migration féminine : une dynamique émergente
Aujourd’hui, les femmes ne sont plus en reste. Confrontées à la polygamie, au mariage forcé, à la précarité économique, de nombreuses femmes entament des parcours migratoires périlleux, parfois enceintes, souvent vulnérables.
Ce phénomène remet en cause la figure classique du migrant masculin. La multiplication de drames humains — tels que la mort de mères et enfants sur les routes migratoires — témoigne de l’ampleur de cette tragédie.
Arrivée en Europe : désillusions et marginalité
Le mythe européen s’effondre rapidement. À l’arrivée, les migrants affrontent des obstacles administratifs, des difficultés d’intégration, et une précarité renforcée par l’absence de titre de séjour.
Le choc éducatif aggrave cette marginalisation : formés à un système d’apprentissage par cœur, les jeunes doivent soudain développer des compétences critiques et analytiques, sans y avoir été préparés.
Les réponses inadaptées des gouvernements africains
En Guinée, les politiques migratoires se limitent souvent à des opérations de communication. Les retours forcés sont mis en scène, mais sans dispositif sérieux de réinsertion. Faute de perspectives, beaucoup de jeunes repartent clandestinement, reproduisant un cycle d’exil et de souffrance.
Pour lutter efficacement contre l’émigration clandestine, il serait nécessaire de : – Refonder l’éducation nationale en formant les enseignants ; – Développer des formations professionnelles adaptées ; – Créer des emplois stables dans les secteurs stratégiques ; – Réformer les injonctions familiales imposant l’assistance financière aux migrants.

La compréhension des dynamiques migratoires ouest-africaines requiert une approche structurelle, attentive aux imbrications complexes des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. Loin d’être une fuite individuelle ou conjoncturelle, l’exil constitue une réponse systémique aux impasses multiples que connaissent les sociétés africaines contemporaines.
Tant que les gouvernements continueront d’ignorer ces déterminants profonds, les départs massifs, notamment des jeunesses, persisteront — avec leur cortège de drames humains, d’errances invisibilisées et de ruptures sociales.
Dans un contexte marqué par le repli identitaire européen et la désagrégation des projets politiques endogènes, il est désormais impératif de penser la migration non comme une anomalie, mais comme un symptôme révélateur des dysfonctionnements structurels de nos systèmes politiques et économiques.
Par Docteure Yassine Kervella-Mansaré,
anthropologue