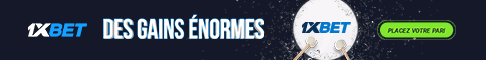Le 2 octobre 1958, la Guinée entrait avec éclat dans l’histoire en disant « non » à la colonisation et « oui » à la souveraineté. Ce choix courageux lui valut admiration, pressions et isolement, mais il symbolisait la quête de dignité d’un peuple décidé à tracer sa propre voie. Soixante-sept ans plus tard, l’indépendance politique est une réalité acquise, mais l’indépendance économique et sociale reste encore un horizon lointain.
Car malgré un potentiel immense et une succession de réformes, la Guinée demeure prisonnière de contradictions structurelles. Le pays enregistre de la croissance, mais sa population s’appauvrit. Les ressources sont abondantes, mais elles ne se transforment pas en prospérité partagée. La souveraineté politique est devenue un acquis historique, mais elle n’a pas encore donné naissance à une véritable souveraineté économique.
La croissance minière, moteur fragile d’une économie déséquilibrée
En 2024, la Guinée a affiché une croissance de 5,7 % selon la Banque mondiale. Cette performance repose presque exclusivement sur l’exploitation minière, en particulier la bauxite — dont la Guinée détient les plus grandes réserves mondiales — et l’or, en hausse constante. À l’horizon, le projet Simandou, avec ses gigantesques réserves de fer, nourrit encore davantage d’espoirs.
Mais cette croissance est trompeuse. Elle repose sur un secteur à forte intensité capitalistique et à faible intensité d’emplois. Autrement dit, l’économie produit de la richesse sans offrir d’emplois aux milliers de jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail. L’insertion professionnelle reste un casse-tête national, et les chiffres officiels du chômage (5,3 % en 2023) ne reflètent en rien la réalité vécue par une jeunesse désœuvrée et sous-employée.
À titre comparatif, des pays comme la Côte d’Ivoire et le Ghana, sans disposer des mêmes ressources minières, ont su diversifier leurs économies en misant sur l’agriculture (cacao, café, anacarde) et les services. Résultat : leur croissance a généré plus d’emplois et un tissu économique mieux équilibré.
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Le Produit Intérieur Brut (PIB) s’élève désormais à environ 25,3 milliards USD. Pourtant, plus de la moitié de la population — 52 % — vit sous le seuil de pauvreté. L’inflation, mesurée à 3,1 % en 2024, ronge le pouvoir d’achat des ménages et entretient la précarité. Les recettes fiscales stagnent autour de 13,1 % du PIB, bien en dessous du seuil requis pour financer des politiques publiques ambitieuses.
Sur le plan budgétaire, la situation se détériore : le déficit s’est aggravé, atteignant –3,1 % du PIB en 2024. Les réserves de change ne couvrent plus que 1,2 mois d’importations, contre 1,9 mois l’année précédente. Quant à la dette publique, elle s’établit à 47,8 % du PIB, exposant le pays au risque d’un endettement insoutenable en cas de choc externe.
Ces indicateurs révèlent une réalité crue : la croissance existe, mais elle ne se traduit ni par une amélioration des conditions de vie ni par un renforcement des capacités de l’État. Pendant ce temps, le Sénégal, avec des recettes fiscales supérieures à 18 % du PIB, parvient à financer davantage d’infrastructures et de programmes sociaux.
Les promesses non tenues de l’indépendance
Au lendemain de 1958, l’ambition était claire : bâtir un État fort et autonome, capable de se développer par ses propres moyens. Mais la rupture brutale avec l’ancienne puissance coloniale, suivie de décennies de programmes d’ajustement structurel dictés par le FMI et la Banque mondiale, a fait dévier le cap.
Ces politiques, conçues selon des modèles génériques, ont souvent ignoré les réalités locales. Elles ont imposé des mesures de rigueur budgétaire, de privatisation et de libéralisation qui ont fragilisé un tissu économique déjà précaire. Plus de soixante ans après, la Guinée reste enfermée dans un modèle rentier, sans stratégie nationale cohérente de transformation et de diversification.
Pendant ce temps, le Ghana, qui a connu lui aussi des ajustements structurels sévères, a progressivement corrigé sa trajectoire en misant sur la bonne gouvernance budgétaire et la diversification de ses exportations.
Les failles de la gouvernance
La question centrale demeure celle de la gouvernance. L’opacité dans la gestion des revenus miniers, les exonérations fiscales injustifiées, la corruption et la faiblesse institutionnelle alimentent la méfiance et minent l’efficacité des politiques publiques. La Guinée figure parmi les pays les moins bien classés en matière d’Indice de Développement Humain, occupant le 181ᵉ rang sur 193 en 2023.
À cela s’ajoute une économie informelle qui représente plus de 40 % du PIB et 96 % des emplois. Cette informalité massive prive l’État de recettes et enferme une grande partie de la population dans une précarité sans protection sociale.
À titre de contraste, des pays comme le Rwanda, partis de beaucoup plus loin, ont su réduire significativement l’informalité grâce à des politiques de numérisation, de bancarisation et de soutien aux PME.
L’urgence d’un nouveau cap
À 67 ans, la Guinée doit impérativement redéfinir son modèle économique et social. Le temps des politiques dictées de l’extérieur est révolu. Le pays doit concevoir et mettre en œuvre sa propre vision, adaptée à ses réalités et à ses aspirations.
Cela suppose d’abord une rupture avec la mauvaise gouvernance (chose qui est entamé avec l’avènement de la CRIEF) : transparence totale sur les revenus miniers, lutte continue contre la corruption, réduction des exonérations abusives et numérisation des régies financières.
Cela exige aussi comme indiqué dans le programme Simandou 2040, une diversification résolue de l’économie : développer l’agriculture pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, stimuler l’industrie de transformation pour retenir plus de valeur ajoutée, et investir dans les services modernes, en particulier le numérique.
Mais aucune réforme ne sera durable sans investissement dans le capital humain. L’éducation, la formation professionnelle et la santé doivent devenir des priorités absolues pour former une génération capable de porter la transformation. Enfin, le renforcement des institutions démocratiques, reste une condition incontournable pour instaurer la confiance et la stabilité.
Conclusion : l’indépendance économique, le vrai défi
Soixante-sept ans après avoir dit « non » à la dépendance coloniale, la Guinée doit dire « non » à la dépendance économique, institutionnelle et politique. Nos ressources minières, aujourd’hui célébrées, pourraient devenir notre malédiction si elles ne sont pas converties en infrastructures, en emplois, en écoles et en hôpitaux.
L’histoire ne retiendra pas seulement la bravoure du « non » de 1958. Elle jugera surtout notre capacité à transformer nos richesses naturelles en prospérité collective. Le temps des hésitations est révolu : l’indépendance véritable se jouera sur le terrain économique et social, ou elle restera une promesse inachevée.
Par Safayiou DIALLO