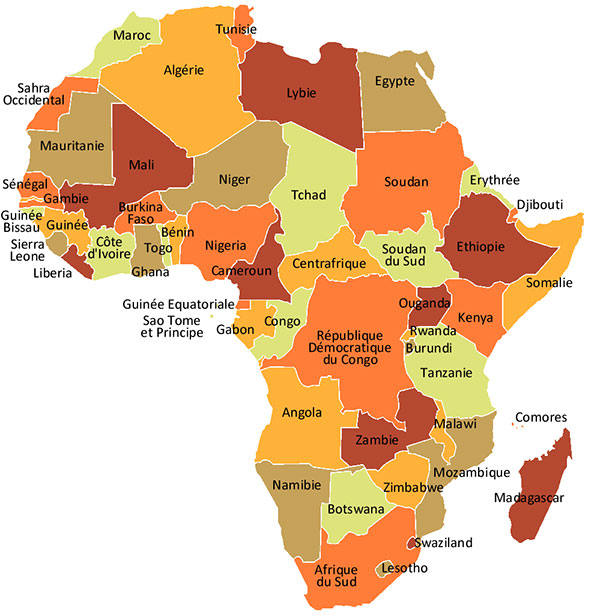Après un peu plus d’un demi-siècle d’accession à la pleine souveraineté, les Etats africains sont malheureusement toujours butés à la problématique de la démocratisation effective. Cela est d’autant plus vrai qu’en dépit de la vague de démocratisation amorcée au début des années 1990 dans la plupart des pays du continent, balayant ainsi plusieurs décennies de régime de partis uniques et de juntes militaires, la conception du pouvoir est restée inchangée : un seul individu élu au suffrage universel direct continue de détenir entre ses mains, et dans celles des siens, l’ensemble des leviers décisionnels. Ce qui fait dire à de nombreux observateurs que la première cause du malheur des Africains est la centralisation des pouvoirs entre les mains d’un seul homme.
Même s’il faut nuancer en soulignant que ces derniers temps en Afrique, certains sont tentés par le mirage des hommes en treillis, ces auteurs de coups d’État ayant pris l’habitude de promettre monts et merveilles à une jeunesse nombreuse en colère. D’ailleurs, ces promesses des lendemains meilleurs sont souvent très vite renvoyées aux calendes grecques par les putschistes, notamment ceux du Sahel, qui ont tôt fait de renier leurs propres paroles d’officiers supérieurs ; ils refusent de restituer le pouvoir aux civils, tout en entraînant les pays, dont ils ont confisqué la direction, dans les vallées périlleuses de la déchéance éthique et morale. Le Burkina, le Mali et le Niger sont des cas illustratifs, qui posent actuellement un sérieux problème dans la région avec les coups de boutoirs du JNIM au Mali.
Au regard de la situation actuelle qui prévaut dans maints pays africains, il est loisible de constater que la démocratie labélisée à l’occidentale est censée, d’après certains responsables africains eux-mêmes, ne pas convenir à l’Afrique. La démocratie, avec son système électoral donnant des gagnants et des perdants, est en effet considérée comme étant l’objet de toutes les manipulations et de toutes les compromissions. Beaucoup d’Africains en sont venus à croire que la démocratie se résumait à la tenue périodique d’élections présidentielles. Or, dans de nombreux pays, ces scrutins suscitent une méfiance profonde : loin de renforcer la gouvernance et de régler les problèmes structurels, ils attisent les tensions, accentuent les fractures sociales et nourrissent la crise démocratique. D’où la désaffection croissante des citoyens envers un système incapable de répondre à leurs aspirations.
À l’évidence, le modèle démocratique actuel, centré sur la figure d’un président tout-puissant, semble inadapté aux réalités africaines, marquées par la diversité ethnique, les inégalités régionales et les institutions faibles. Souvent perçues comme un jeu à somme nulle, les élections accentuent les rivalités et favorisent la polarisation de l’espace civique ; la contestation systématique des résultats par l’opposition en est une parfaite illustration. D’où la nécessité de trouver des réponses à ces nombreux défis, qui menacent la stabilité des Etats africains. Il revient donc à l’intelligentsia du continent de trouver un modèle de gouvernance qui s’adapterait à nos réalités socio-économiques. Nous devons de ce fait, nous départir de cette mentalité d’assistés permanents incapables de réagir et de réfléchir face à diverses problématiques.
Thierno Saïdou Diakité