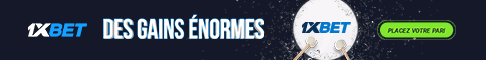L’histoire de la Guinée est une fresque d’espérances trahies, de promesses éblouissantes aussitôt éteintes par la réalité du pouvoir. Depuis l’aube de son indépendance, ce pays, qui aurait pu incarner la maturité politique de l’Afrique francophone s’est enlisé dans une tragédie cyclique : celle des espoirs avortés, des libertés confisquées et des rendez-vous manqués avec l’Histoire.
Dans une perspective analytique, mettant en lumière la configuration asymétrique de l’échiquier politique guinéen, la culture politique qui se caractérise par une dualité ethno-régionaliste et « néo-patrimonial » (I) et l’irruption répétitive de l’armée dans la gestion du pouvoir (II), nous tenterons d’expliquer, un tant soit peu, ce qui fait de la Guinée un pays au destin paradoxal.
- Les dynamiques structurelles du pouvoir en Guinée : entre asymétrie politique, logique ethno-régionaliste et l’irruption des militaires
La configuration du pouvoir en Guinée obéit à des dynamiques structurelles profondément enracinées, qui expliquent en partie la fragilité de son système politique et démocratique. Depuis l’indépendance, l’échiquier politique guinéen se caractérise par une asymétrie politique constante. Cette asymétrie du champ politique guinéen a favorisé l’émergence d’une culture politique à caractère ethno-régionaliste, où les appartenances identitaires et communautaires prédominent souvent sur les clivages idéologiques (A).
C’est justement dans ce contexte d’imbroglio politique et ethno-régionaliste que l’armée s’est présentée non seulement comme une force d’arbitrage, mais aussi comme un acteur politique à part entière (B), justifiant ainsi ses interventions répétitives dans la gestion du pouvoir politique par la nécessité de « sauver la République »
- La culture politique en Guinée : de l’ethno-régionalisme au néo-patrimonialisme.
L’échiquier politique guinéen a toujours été un espace de compétition symbolique entre les groupes ethnico-régionaux. C’est pourquoi le rapport au pouvoir repose sur une double logique : ethnique et néo-patrimoniale. D’un côté, les communautés perçoivent l’État comme le seul garant de leur protection sociale et identitaire, transformant la conquête du pouvoir en enjeu de survie collective. De l’autre, les élites politiques voient dans le pouvoir un instrument d’enrichissement et de préservation des privilèges. Ce double réflexe a engendré une gouvernance fondée sur la loyauté de façade et le clientélisme plutôt que sur les valeurs de compétence et le mérite. Ainsi, l’État, devenu un espace de prédation, s’est enfoncé dans une crise chronique, marquée par la corruption, l’instabilité et la reproduction des mêmes logiques de rente à chaque régime politique.
- De la crise de l’État à la militarisation du pouvoir politique en Guinée
De Sékou Touré au Général Mamadi Doumbouya, chaque régime politique en Guinée a reproduit, sous des formes variées, le même schéma de conquête, d’exercice et de conservation du pouvoir politique. Les coups d’État de 1984, 2008 et 2021 témoignent de cette cyclicité du pouvoir militaire, qui traduit non pas une vocation politique des forces armées, mais plutôt la faillite des institutions politiques à incarner un arbitrage neutre et crédible du fonctionnement de l’État, ainsi qu’une crise de gouvernance marquée par l’exacerbation de la pauvreté, le chômage généralisé des jeunes et le désespoir des populations.
Face à cette déliquescence du pouvoir civil et à la multiplication des crises ethno-régionalistes, l’armée s’est progressivement présentée comme le dernier rempart de la nation et du peuple. Héritière directe d’une tradition de discipline et d’unité, elle s’est investie d’une mission de « sauvegarde des valeurs de la République ». Dès lors, chaque épisode de crise politique majeure a servi de prétexte à un coup d’État militaire, souvent justifié par le besoin de « la refondation de l’État et rectification institutionnelle » faisant de la Guinée un pays des rendez-vous manqués avec l’Histoire – vide partem secundam.
- Le paradoxe guinéen : de l’espérance à la désillusion
La Guinée occupe une place singulière dans l’histoire politique de l’Afrique contemporaine. Première ancienne colonie française d’Afrique subsaharienne à dire « NON » à la Communauté française en 1958, elle s’érigeait alors en symbole éclatant de la dignité africaine et de la souveraineté retrouvée. Ce choix courageux, porté par Ahmed Sékou Touré, incarnait l’espoir d’un État nouveau, affranchi des tutelles étrangères et tourné vers la justice sociale, l’unité nationale et le développement durable.
Mais plus de six décennies après cette indépendance héroïque, la Guinée semble prisonnière d’un cycle d’éternel recommencement, d’instabilités et de régressions des valeurs démocratique (A). Ce contraste entre l’espérance fondatrice et la désillusion historique constitue le symbole par excellence du paradoxe guinéen (B)
- Les illusions du centralisme révolutionnaire et l’échec de la première tentative de transition démocratique
Sous Ahmed Sékou Touré, père fondateur de la nation, la Guinée a cru, un instant, écrire une épopée d’émancipation et de stabilité. Mais l’élan révolutionnaire s’est vite mué en un centralisme implacable occasionnant vingt-six années de parti unique et transformant le rêve d’indépendance en cauchemar : culte de la personnalité, répression, exils et exécutions sommaires. L’État, finalement confondu avec un homme, a étouffé la République sous le poids du dogme et de l’instauration d’un État policier.
Toutefois, la mort de Sékou Touré en 1984 aurait pu ouvrir la voie à un renouveau démocratique. Car le coup d’État du général Lansana Conté inaugura une première tentative de transition démocratique avec l’adoption de la Loi Fondamentale du 23 décembre 1990.
Peu à peu, derrière cette façade de libéralisation de la vie politique et économique, la Guinée a glissé dans le clientélisme, la corruption et l’ethno-régionalisme. L’État était devenu l’enjeu de prédation des élites, et non plus le moteur du développement socioéconomique. Pendant vingt-quatre ans de régime militaire, la Guinée vivait au rythme des crises multidimensionnelles.
- De 1958 à nos jours : itinéraire d’une espérance trahie
L’histoire politique de la Guinée s’ouvre sur un acte fondateur d’une portée symbolique exceptionnelle. La mort du Général Conté en 2008 aurait également pu ouvrir un nouveau chapitre. Mais les années qui ont suivi sa mort ont été rythmées par des transitions avortées, des promesses non tenues et des crises démocratiques.
En 2010, l’élection du professeur Alpha Condé a été perçue comme un retour de l’espoir démocratique. L’arrivée au pouvoir du premier président civil élu symbolisait la possibilité d’une alternance, d’une réforme des institutions et la naissance d’un État de droit. Mais cet optimisme s’est progressivement mis à mal par des pratiques politiques qui rappellent les travers du passé : l’ethno-stratégie, le clientélisme, le favoritisme et le tripatouillage constitutionnel perpétré en 2020, offrant un troisième mandat au Pr Alpha Condé en violation des dispositions de la Constitution de mai 2010. La promesse d’alternance démocratique et de respect des règles du jeu démocratique a à nouveau été bafouée.
C’est dans l’exercice de ce 3ème mandat du Pr Alpha Condé qu’intervient le coup d’État du 5 septembre 2021, mené par le Groupement des forces spéciales, à sa tête le Colonel (à l’époque des faits) Mamadi Doumbouya. En renversant le Pr Alpha Condé, une bouffée d’espérance parcourut le pays. La promesse de « refondation et de rectification institutionnelle » résonna comme un écho du passé : celui de chaque aube nouvelle qui finit par ressembler au crépuscule précédent. Quatre ans plus tard, la rupture promise s’est muée en une continuité qui plongera le pays dans un éternel recommencement. Cette situation désastreuse n’est pas seulement l’échec des hommes et femmes, mais celui de plusieurs générations dont l’avenir est hypothéqué par une bureaucratie civilo-militaire.
Ainsi, en désespoir de cause, je suppose, peut-être naïvement, que le véritable rendez-vous avec l’histoire n’est pas encore advenu : celui où la Guinée cessera d’attendre un libérateur, pour enfin s’émanciper par elle-même.
Aly Souleymane Camara
Analyste politique et Enseignant-chercheur
à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia