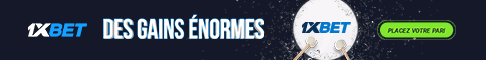Le 11 novembre à 11h 11 (comme le rappelle à juste titre Thione Niang) s’est tenue à Moribayah, dans la préfecture de Forécariah, la cérémonie de lancement de l’exploitation de Simandou, le plus grand projet minier d’Afrique.
Simandou a longtemps alimenté le débat public, particulièrement sur les médias sociaux. Djiba Diakité, directeur de cabinet de la Présidence et président du comité stratégique de Simandou, en est la figure la plus en vue. Il a entretenu une certaine confusion en évoquant un « programme Simandou » distinct du « projet Simandou », ainsi qu’un concept baptisé Simandou 2040. Cette distinction reste floue aujourd’hui, la communication gouvernementale sur le sujet demeurant insuffisante. Pour obtenir des informations fiables, il faut souvent se tourner vers les médias anglo-saxons, français ou australiens, faute de celles fournies par Rio Tinto Simfer.
La cérémonie a conduit le gouvernement guinéen à décréter le 11 novembre jour férié sur l’ensemble du territoire, alors même que l’événement ne concernait directement qu’un cercle restreint de personnes : les actionnaires du projet, quelques officiels, ainsi que des invités de marque tels que les présidents Paul Kagamé et Brice Oligui Nguema, le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong.
L’État guinéen avait également convié plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les Premiers ministres de Côte d’Ivoire et de Sierra Leone, qui ont honoré de leur présence aux côtés des membres du gouvernement guinéen.
Les regards des Guinéens, de l’intérieur comme de la diaspora, étaient tournés vers cet événement majeur. La cérémonie s’est globalement bien déroulée. Toutefois, les interventions des représentants guinéens n’ont pas été à la hauteur de l’importance du moment, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment après la diffusion d’un extrait du discours de Djiba Diakité, devenu rapidement viral. La présente analyse vise à examiner de manière rigoureuse et objective le déroulement de cette cérémonie.
Modération maladroite
La modération de l’événement était assurée par un certain Christian et une certaine Aïcha, qui se tutoyaient sur scène. Elle, comme l’ensemble de la cérémonie, était largement centrée sur la figure de Mamadi Doumbouya, président de la transition, présenté comme le principal artisan du projet Simandou. Pourtant, ce projet, découvert dès 1950 et dont les permis d’exploitation ont été attribués à Rio Tinto en 1997 pour les blocs 1 à 4, s’inscrit dans une longue continuité institutionnelle.
La mise en scène était exagérée, pompeuse et excessivement lourde. Les fautes, les maladresses et la grandiloquence ont rendu la présentation pesante. Or, une modération n’est ni un concours d’éloquence ni un exercice de déclamation, encore moins une tribune de glorification. Le rôle du modérateur est d’informer le public, de rythmer la cérémonie et d’éviter les silences inutiles : il est, en somme, le chef d’orchestre de l’événement.
Au lieu de multiplier les louanges envers Mamadi Doumbouya, les modérateurs auraient gagné à mieux connaître le projet Simandou et à en exposer les enjeux. Leurs interventions, marquées par un niveau de langue approximatif, ont manqué de précision et de sobriété, notamment du côté de Christian, dont les excès ont été particulièrement notables.
Le train de la compagnie du TransGuinéen
Lors de la présentation du train de la compagnie du TransGuinéen, le président Mamadi Doumbouya est monté dans la cabine pour manipuler brièvement les commandes, sans toutefois piloter le wagon, contrairement à ce qu’avait annoncé le modérateur. Quelques instants plus tard, Djiba Diakité l’a rejoint et a insisté pour poser à ses côtés avec les conducteurs. Le président, visiblement agacé, a refusé et quitté la cabine.
Cette séquence illustre la propension du directeur de cabinet à se mettre en avant, alors qu’il devrait, au contraire, rester en retrait.
Par ailleurs, alors que le président Doumbouya se trouvait en compagnie de ses homologues rwandais et gabonais, Djiba Diakité l’a isolé pour poser devant un wagon portant les inscriptions « KÓMA » et « Président Général Mamadi Doumbouya ». Kóma étant le village natal du chef de l’État, ce baptême symbolique d’un train appartenant à la Guinée envoie un message maladroit. Il véhicule une image de personnalisation du pouvoir et d’appropriation symbolique des biens publics.
Il convient de rappeler que les biens de l’État n’appartiennent pas à des individus, fussent-ils au sommet de la République. Ces inscriptions traduisent une tendance inquiétante à la personnalisation du pouvoir, alors même que Mamadi Doumbouya n’a jamais donné de signes de repli communautaire. Il est donc urgent que le cabinet de la présidence veille à éviter de telles situations, qui peuvent nuire à l’image du chef de l’État et du pays.
Culte de la personnalité et mégalomanie
Les tribunes officielles étaient dominées par un immense portrait de Mamadi Doumbouya, donnant à la cérémonie des allures d’investiture plutôt que de lancement d’un projet minier. L’attention aurait dû être centrée sur le projet lui-même, non sur la personne du président. Cette mise en scène participe à l’installation d’un culte de la personnalité, symptomatique d’une communication démesurée.
Dans l’ensemble des discours, le président a été davantage cité que le projet Simandou. Chaque intervenant y allait de sa formule laudative, comme s’il fallait flatter le chef de l’État pour capter son attention. Les partenaires étrangers, notamment les dirigeants de Rio Tinto et de Winning Consortium Simandou, ont prononcé leurs allocutions respectivement en anglais et en mandarin sans traduction immédiate. En revanche, lorsque le président du conseil d’administration de Baowu Resources a ouvert son discours en saluant expressément Mamadi Doumbouya, les applaudissements venus du rang des délégations chinoises ont provoqué un sourire du président, qui s’est alors précipité sur le traducteur pour écouter attentivement.

Ce détail symbolique montre à quel point la personnalisation du pouvoir peut influencer la perception et les comportements diplomatiques. Il est urgent de corriger cette distorsion afin d’éviter que l’émotion et la flatterie ne deviennent des leviers de décision.
Les discours et l’entorse à l’image du pays
Le cycle des interventions guinéennes a été ouvert par Mamoudou Nagnalen Barry, président du conseil d’administration de la compagnie du TransGuinéen. Dans une allocution, il a précisé que le TransGuinéen est propriétaire des infrastructures portuaires (rails, deux ports minéraliers et un port commercial) et que ses partenaires sont Baowu Resources, Rio Tinto, Chinalco et Winning Consortium Simandou. Malgré son ton posé, il a commis une légère erreur linguistique en déclarant : « Merci pour les opportunités que vous nous offertes », au lieu de « que vous nous avez offertes », ou « que vous nous offrez ». Certes une maladresse mineure, mais elle mérite d’être soulignée pour faire le panorama de l’événement.
Le discours de clôture, prononcé par Djiba Diakité, a été largement critiqué et à juste titre. Le niveau d’expression, le manque de cohérence et l’absence de structure ont entaché la qualité de sa prestation. Il serait souhaitable qu’il bénéficie d’une formation à la prise de parole en public, d’un « media training » et que son cabinet s’offre les services d’un conseiller discours ou d’une plume.
Le discours manquait totalement de fil conducteur et de pertinence. Il s’agissait d’un enchaînement confus de mots et d’expressions sans lien logique, révélant une pauvreté lexicale sans précédent dans l’histoire politique récente de la Guinée et à ce niveau de responsabilité. Cette faiblesse, au-delà du cas individuel, renvoie à un enjeu plus large : la nécessité de professionnaliser la communication de l’État pour préserver l’image et la crédibilité des institutions et, au premier chef, de la présidence de la République.
Entre chaque paragraphe, Djiba s’essuyait le front avec sa main, cherchait des ovations qui ne venaient pas, souriait à toute allure. À la tribune, Paul Kagamé était dépassé et le Premier ministre Bah Oury gêné devant une telle prestation qui laissera des séquelles dans l’opinion publique et abîme déjà la réputation de la Guinée. Car si les invités de haut rang n’ont rien dit publiquement, dans les couloirs diplomatiques, les interrogations se feront sentir.
Par ce discours, Djiba Diakité met en doute sa formation en France et les expériences qu’il dit avoir acquises dans le secteur bancaire, y compris en communication stratégique dont il se déclare expert.
Djiba Diakité n’en est pas à son premier essai. C’était déjà le cas lors du lancement de Branding Guinée ou encore dans une interview où il parle de « 14 km de docs contractuels ». À ce niveau, rien ne peut excuser ses erreurs et rien ne peut les défendre. La Guinée compte d’excellents jeunes communicants, ceux dont le métier est d’écrire un récit, de raconter un événement, d’élaborer des messages, de construire une réputation, de façonner une image et de bâtir une notoriété, mais aussi de créer du lien. Il faut oser donner de hautes responsabilités aux jeunes qui savent, même s’ils sont critiques envers le gouvernement.
C’est aussi faire preuve de grandeur que de reconnaître ses limites et de tenter de les corriger. Djiba Diakité, en qualité de directeur de cabinet de la Présidence, doit s’effacer. Il parle toujours au nom et pour le compte du président, même en sa présence. Le paradoxe de l’organisation des services de la Présidence tient au fait que tout le monde effectue le travail de tout le monde. Le général Amara Camara, en plus d’être Secrétaire général de la Présidence, est aussi porte-parole de celle-ci. Lui et Djiba Diakité sont plus en vue que le président Doumbouya.
L’effacement du Président de la transition et un rendez-vous manqué pour l’histoire
Le président Doumbouya est devenu un spectateur des grands rendez-vous de l’histoire du pays. À Moribayah, Djiba Diakité ne devait pas prononcer de discours devant le président. C’est Mamadi Doumbouya en personne qui devait s’exprimer à la tribune pour rappeler le travail réalisé, les résultats accomplis, les enjeux du moment, les défis qui se profilent et les opportunités qui se créent et se poursuivront. C’est lui le patron. Les rôles sont inversés et cela commence à trop durer.

Simandou sera le projet le plus important de la gouvernance de Mamadi Doumbouya. Aucun autre ne l’égalera. Il est ainsi regrettable que le président ne s’inscrive pas dans la postérité et que ses deux proches collaborateurs lui fassent de l’ombre alors qu’ils devraient rester en retrait et en soutien du chef de l’État.
Par ailleurs, Djiba Diakité a dit quelque chose de très intéressant dans son discours : « Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation ; la toute première délégation officielle, à se rendre en Chine, après la crise planétaire de Covid19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Nous avons obtenu l’accord de Shanghaï qui a permis de relancer que les travaux que voyez présents sur ce lieu, qui n’était que des forêts et des mangroves. »
Sans juger la forme tordue de cette affirmation, le directeur de cabinet de la Présidence dévoile là l’inversion des pouvoirs. Le projet Simandou, contrairement aux discours officiels, s’est décidé en Chine, qui a une emprise très importante dans la production et l’exportation du minerai de fer stratégique.
Parce qu’elle produit plus de la moitié du marché mondial de l’acier, la Chine a des intérêts stratégiques en Guinée. Le groupe chinois Baowu Steel est le plus grand producteur d’acier au monde, d’où sa présence très importante dans le projet Simandou.
Engagée dans une dynamique de développement accélérée et de course à l’innovation, le secteur du BTP tourne à plein régime en Chine. Le fer est donc une matière première vitale pour le programme de transformation du pays. Très dépendante de l’Australie, la Chine voit dans l’Afrique une opportunité de diversifier ses approvisionnements.
La Guinée détient ce que la Chine veut ; elle met donc les moyens pour l’obtenir. D’ailleurs, le 6 septembre 2021, au lendemain du coup d’État contre Alpha Condé, pour une des très rares fois, la Chine est sortie de sa réserve habituelle pour condamner le putsch car elle craignait pour ses intérêts économiques.
Les discours sur la souveraineté entonnés çà et là en Guinée prêtent à sourire dans les chancelleries occidentales. Il est aujourd’hui important de veiller à ce que ce projet profite directement à l’ensemble des Guinéens et amorce le véritable décollage du pays.
La fonction de directeur de la communication trahie
Les prises de parole étaient modérées par le directeur de la DCI (Direction de l’Information et de la Communication) de la Présidence de la République. Cet exercice n’est pas son panthéon familier et cela se voyait. Les guéguerres de leadership entre lui et le chef de la Division Digitale, Moussa Daraba, le poussent à s’efforcer de prendre la parole. Il refuse ainsi de permettre à Daraba, pourtant rompu à cet exercice, de jouer ce rôle de peur de perdre son poste.
À la DCI, le directeur est aussi au centre d’une crise d’autorité car son équipe sait qu’il a encore beaucoup à apprendre en communication, et que le rôle qui lui est confié est trop lourd à porter, d’autant qu’il n’accepte pas toujours de se faire conseiller.
Un directeur de la communication n’est pas un modérateur. Il coordonne l’ensemble de l’action de communication et veille à ce que l’événement se déroule dans de bonnes conditions en lien avec le directeur de cabinet. Lui qui était censé se mettre en retrait pour observer et corriger d’éventuelles failles, refuse d’embrasser l’ombre, car il faut que le président le remarque, et ainsi toute velléité de le remplacer serait écartée.
Le directeur peinait à lire ce qu’il avait pourtant écrit, titubait souvent et commettait des fautes graves. Il se trompait dans les fonctions des invités. Par exemple, il a affirmé que Brice Oligui Nguema était le président du Rwanda, alors que quelques secondes avant, il avait appelé Paul Kagamé président du Rwanda. Il toisait ses équipes, oubliant qu’il était en direct, et encensait outrancièrement le président et le directeur de cabinet.
Il ne lui appartenait absolument pas, et c’est une grossière erreur protocolaire, de faire un discours. Sa seule présence sur l’estrade aurait dû se limiter à passer le micro ou à introduire le président de la République.
En conclusion, Djiba Diakité doit urgemment s’offrir des cours de media training, prendre ses distances avec Thione Niang, qui semble jouer un rôle de parapluie auprès de lui et de blogueur dans le projet Simandou. Et voici, par ailleurs, une liste de mots que Djiba devrait éviter de mettre dans ses discours le temps d’apprendre à les prononcer convenablement : parcourir, réussite, engagement, concrétisation, retenu, précipitation, tribune, expérience, revenu, conçu.
Le président doit nécessairement rompre avec le silence qui l’habite et endosser pleinement la fonction de chef de l’État. Les armes, les militaires toujours aussi nombreux, y compris lors des réceptions officielles ou pendant le Conseil des ministres, méritent d’être revus. Cela ne donne malheureusement pas une bonne image du pays et c’était visible à Moribayah lorsque Mamadi Doumbouya est monté dans la cabine du train TransGuinéen.
Pour un endroit aussi exigu, il a fallu plus de six gardes. Lorsqu’il est arrivé à la tribune officielle de l’événement, il y avait un excès de présence. La personne qui guidait les militaires avec de grands gestes était visible de tous, alors que des oreillettes auraient suffi.
La DCI doit urgemment changer de fonctionnement. Le directeur actuel ne joue malheureusement pas correctement son rôle et devrait se former en communication pour préserver l’image du pays et la dignité de la fonction.
Le chef du protocole doit être associé pleinement à ce type d’événements et ses avis pris en compte.
Oser la compétence
La Guinée a amorcé un tournant important, voire historique, qui peut la conduire vers la prospérité. Il subsiste malheureusement aujourd’hui des considérations qui freinent cette dynamique, laquelle ne pourra aboutir sans l’engagement des fils et filles du pays. En Guinée comme dans la diaspora, on compte de nombreux jeunes Guinéens talentueux et compétents.
Ces jeunes, souvent critiques à l’égard de la manière dont le pays est géré, ne sont pas des opposants, mais des citoyens exigeants. Il existe une médiocrité ambiante dans l’administration, tout comme une excellence étouffée. La nouvelle génération de jeunes Guinéens talentueux refuse la propagande. Il appartient donc aux pouvoirs publics de rompre avec les pratiques du passé et d’oser enfin faire le choix de la compétence.
Cette nouvelle vague de jeunes intellectuels guinéens refuse de voir le pays confié à des tiktokeurs sans formation solide, des influenceurs ou des charlatans. L’heure est venue de changer notre manière de penser la nation. En servant la Guinée, on ne sert ni un gouvernement ni un homme, mais la nation tout entière. Toutes les forces intellectuelles doivent donc s’unir pour mener à bon port ce bateau de la prospérité et de l’épanouissement.
Le balai des blogueurs au plus haut sommet de l’État constitue une insulte à la nation. Les dirigeants s’accommodent de leurs services pour masquer leurs limites et, dans un griotisme de salons et de bars-cafés, bâtir une illusion de compétence.
Le monde est entré dans une compétition effrénée depuis la Covid-19. Il est urgent de prendre conscience de ce qui se dessine. La nouvelle configuration politique et sociale ne sera plus jamais celle des cinquante dernières années. L’opinion publique sera plus exigeante que jamais et n’hésitera plus à demander des comptes. Les crises vont se multiplier et gouverner seul ne sera qu’une illusion, une utopie.
Face à ces nouvelles configurations géopolitique et sociale, il faut oser la compétence pour faire partie des grandes nations qui comptent et qui résistent aux turbulences du monde.
Mamadou Kossa Camara