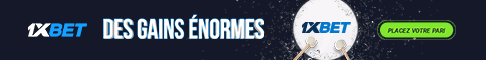Ce 10 juillet, les différentes Coordinations régionales, les sages et le gouvernement signeront à Kaloum le Pacte d’entente nationale pour la paix, l’unité et la cohésion sociale en République de Guinée. Un document conventionnel, élaboré par le CIRD (Centre d’innovation et de recherche pour le développement), pour prévenir les conflits au moment où le pays s’achemine vers des échéances électorales. Pour en savoir plus sur l’initiative, La Lance a interrogé la fondatrice du CIRD, la docteure Safiatou Diallo.
La Lance : Que contient le Pacte d’entente nationale et de cohésion sociale ?
Dre Safiatou Diallo : Le Pacte d’entente nationale est un document issu de la volonté librement exprimée par les Coordinations régionales et les institutions coutumières, qui sont des composantes essentielles de la société civile. Représentant l’ensemble des régions du pays, ces instances incarnent la plus grande force de médiation et de dialogue en Guinée. Elles sont aussi le reflet de notre diversité culturelle, une richesse précieuse pour la construction d’une paix durable.
Au cours des deux dernières années, nous avons mené une étude auprès des communautés pour repérer les formes de conflits et les moyens de leur résolution. Une étude riche en leçons. Nous avons compris qu’au-delà des injustices sociales, qui génèrent des conflits de voisinage et intercommunautaires, il y a un sentiment fort d’appartenance à la terre nourricière Guinée.
Outre ces causes traditionnelles de conflits, les périodes électorales attisent le sentiment de division ethnique, renforcent l’ethno-stratégie. Ce qui débouche sur des violences, y compris avec les forces de l’ordre.
L’esprit du Pacte est de prévenir, d’anticiper et de déconstruire, dans la perspective électorale qui s’ouvre, toute promotion de la violence auprès des populations et des forces de l’ordre. C’est un contrat. Le premier du genre, où les représentants de toutes les communautés nationales conviennent, entre elles, de refuser toute forme de manipulation pouvant conduire à la discorde, à la violence.
Vous trouverez donc dans le Pacte l’idée du respect des individus, de la liberté, de la concorde et de la promotion de la paix qui est le besoin le plus précieux pour chaque Guinéen. La paix est plus précieuse que l’ensemble des ressources naturelles que nous possédons. C’est cette idée qui est exprimée en substance dans le Pacte. Vous y trouverez des détails plus précis.
Il est élaboré par le CIRD, avec un financement du PNUD et de ses partenaires. Comment l’idée vous est-elle venue ?
L’idée du Pacte émerge du constat sur le terrain de l’attachement de nos concitoyens à la paix, de leur résolution de ne pas user de la violence pour régler leurs différends. Nous avons capitalisé sur les besoins exprimés, la volonté manifestée, pour mobiliser les autorités régionales autour de l’idée d’un contrat qui donnerait leur position par rapport à la promotion de la sécurité de chaque citoyen. Le Pacte est donc issu de cette quête qui vise à transformer la société en agissant sur elle, à travers des leviers qu’elle-même aura définis. La vérité est que notre expérience politique des violences lors des différentes échéances électorales a permis de nous convaincre que les politiques se jouent de nos vies et qu’il est temps de penser rationnellement les choses, de sortir des passions pour bien vivre, ensemble, en valorisant nos richesses culturelles et nos différences. Loin d’être conflictuelles, celles-ci doivent être le socle pour bâtir une société d’avenir. La paix y contribue.

Comment a-t-il été élaboré ?
Le Pacte est élaboré sur la base de cette concertation entre les acteurs. Le recueil des données sur le terrain, le sondage des organisations communautaires sur les conflits et leurs modes de résolution ont contribué à l’émergence de l’idée unanime selon laquelle il faut agir ensemble pour la paix. Vivre ensemble n’est profitable que si la cohabitation l’emporte sur la coexistence. Dans la cohabitation, il y a l’idée de faire ensemble, de penser ensemble, de construire ensemble. Cela ne signifie pas qu’il faut être d’accord, unanime sur tout. Mais que parfois, de nos désaccords peut jaillir la lumière qui éclaire le chemin de notre développement individuel et communautaire. C’est dans cet esprit que le Pacte a été élaboré, en associant les différents acteurs, par le refus de la violence comme mode de résolution des crises sociales et politiques dans notre pays.
Quelles sont les sources de conflits en Guinée ?
Les sources de conflits sont nombreuses : les questions domaniales, d’héritages, les relations entre agriculteurs et éleveurs… Mais si ces conflits passent souvent par des médiations coutumières, il n’en est pas de même des conflits politiques. La manipulation de l’ethnicité comme force politique favorise des clivages entre des personnes ayant toujours vécu ensemble sans mettre en avant leurs particularismes anthropologiques comme des signes de différenciation dans l’expression de leur humanité. Et généralement, c’est ce que les politiques réussissent à construire, faute d’avoir de projets politiques viables.
Sortir de la manipulation ethnique au profit des choix fondés sur le principe de la capacité, c’est encourager une décision rationnelle. Cela est souvent difficile dans un pays où l’analphabétisme est toujours un problème, où au cours des dernières décennies l’ethno-stratégie est apparue comme l’unique possibilité d’accéder au pouvoir. Aujourd’hui, par ce Pacte, les acteurs sont conscients que ce n’est pas l’ethnie qui gouverne ou qui doit gouverner, mais la compétence. Ce qui est en jeu, c’est la capacité à développer notre pays et à faire en sorte que chaque citoyen puisse jouir de ses richesses dans la dignité.
Comment y mettre fin ou tout au moins atténuer les conflits ?
L’Unesco nous enseigne que « les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, et c’est dans l’esprit des hommes qu’il faut élever les défenses de la paix ». La paix ne tombe pas du ciel, elle se construit. Elle est faite de négociations, de transactions, de médiations et de sensibilisations. C’est ce travail qu’il nous faut amplifier, nous les Chercheurs dans les universités, mais aussi les Coordinations régionales, les personnalités coutumières, les religieux en tant que forces de médiation et l’État. Il nous faut investir dans la citoyenneté, dans les valeurs qu’elle promeut en vue de transformer nos manières de penser et d’agir. C’est en cela que nous parviendrons à l’esprit de responsabilité. Responsabiliser chaque citoyen sur son rôle, ses droits et ses devoirs, et le rendre conscient de les vivre à tout moment, c’est cela l’éthique citoyenne. Elle repose sur la nécessité que l’on soit toujours prêts à assumer pleinement les conséquences de nos actes, avant même de les poser. L’engagement des Coordinations régionales, la mobilisation des organisations coutumières et des sages autour de la promotion de la paix passent aussi par ces enseignements qui seront vulgarisés par elles. La paix est une affaire individuelle, avant d’être une nécessité sociale.
Les conflits en Guinée étant en partie provoqués par les politiques, leur résolution ne serait-elle pas d’ordre politique ?
En effet, les seules fois où les conflits prennent des proportions inquiétantes, c’est lorsqu’elles sont liées à la politique. La passion politique est déraisonnable généralement, et cela est davantage visible dans nos pays. Les foules de militants ne pensent pas, elles agissent. Elles sont agies par des idées qu’elles ne maîtrisent souvent pas, et encore moins les conséquences prévisibles de leurs actes. C’est pourquoi l’éducation à la citoyenneté, qui prévaut depuis l’institution de l’État en 1958, invite à déconstruire les ethnies comme force politique, comme force en politique.

Cette déconstruction est vitale à la veille des élections qui nous permettront de revenir à l’ordre constitutionnel. Et ce ne sont pas d’abord les politiques qui doivent y contribuer, mais chaque citoyen à son propre niveau, depuis la famille, en passant par l’école jusque dans les organisations de la société civile. La paix se construit à la base. Et c’est cette paix qui est durable. Elle n’a pas à être imposée par le politique, ou les pouvoirs politiques, elle se doit d’être l’émanation des populations. Et c’est l’exemple que donne le Pacte entre les différents acteurs de résolution des conflits et du maintien de la paix de notre pays. Ainsi, on observe comment un peuple devient un peuple : en renonçant à la violence comme mode de résolution des conflits, pour privilégier la raison et la paix.
Quel est le rôle de l’État dans ce cadre ?
Les Coordinations et les sages offrent par ce Pacte la possibilité à l’État de promouvoir la paix et de la garantir. L’idée est que l’État est « le détenteur du monopole de la violence légitime ». Cela ne veut pas dire qu’il doit s’en servir comme solution de résolution privilégié des conflits. La paix qu’offrent les Coordinations invite l’État à la retenue. Les forces de l’ordre et de défense doivent s’inscrire dans l’esprit de citoyenneté et de respect de la loi. Elles doivent se remémorer la finalité première de l’État : garantir la sécurité des citoyens et non empiéter les droits de ces derniers. L’État est donc un acteur dans la promotion de la paix. C’est pourquoi dans le Pacte, l’État est cosignataire.
Si les communautés s’instituent en peuple en sortant d’un état de violence pour celui de paix par la raison, l’État, en le validant, s’assure de veiller à la préservation de la paix. Il en devient le garant. C’est en ce sens que ce Pacte nous offre, pour la première fois, une possibilité de reconstruire la société et l’État sur des bases nouvelles. Celles de la co-construction des conditions nécessaires et indispensables à la construction de la citoyenneté par la liberté, l’égalité et la paix. Ce Pacte exige de chacun des acteurs mobilisés une responsabilité infinie dans la préservation de la paix dans notre pays. L’enjeu est là : il est individuel, communautaire et politique. Nous sommes tous responsables de la paix qui est notre bien le plus précieux.
Interview réalisée par
Diawo Labboyah Barry