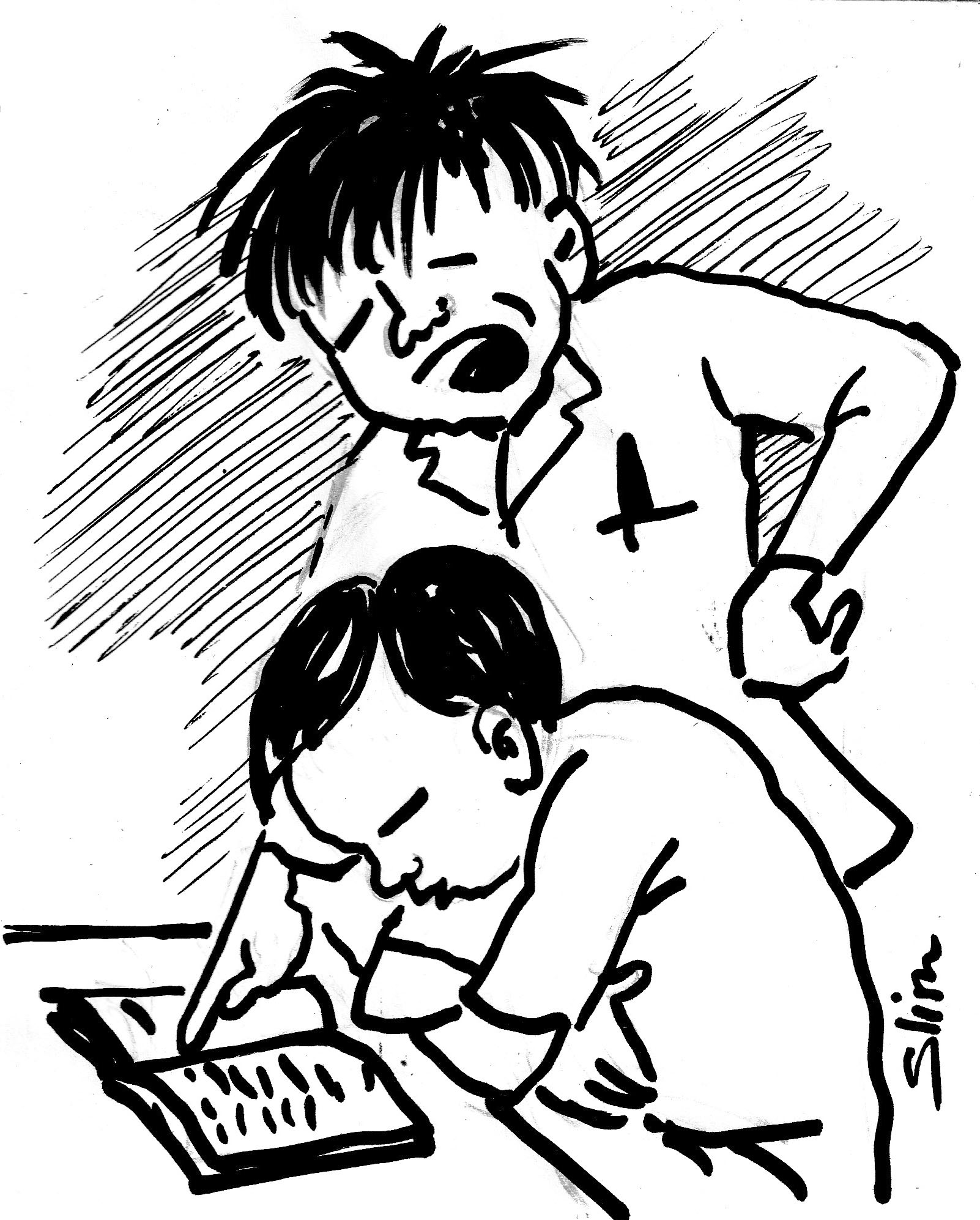Tant vaut l’école, tant vaut la nation. Cette réflexion du philosophe français Ferdinand Buisson est vérifiée par l’observation empirique et la science. Il suffit de regarder autour de soi et de scruter l’histoire pour constater que les nations qui ont fait un bond socioéconomique prodigieux sont celles qui ont pris à bras-le-corps l’éducation. La qualité et le développement d’une nation sont directement liés à la qualité de son système éducatif. L’école, transmet les savoirs, les valeurs et les compétences, forme les citoyens de demain et contribue à la construction et à la prospérité de la société.
Un système éducatif solide forme des hommes capables de raisonner, de s’adapter et de contribuer activement au développement économique, social et culturel. Si l’école est défaillante, la nation en subira les conséquences à terme, elle n’est pas en mesure de construire son avenir. La force et l’avenir d’une nation dépendent de la capacité de son système éducatif à former des citoyens éclairés et compétents. C’est dans cette perspective que Jules Ferry, Ministre de l’Instruction publique en France, rend obligatoire et gratuite l’école. A la même époque les fabuleux progrès scientifiques, technologiques et techniques entraînent en Amérique du Nord, en Europe et dans quelques pays asiatiques le développement de l’enseignement et de la recherche.
Plus proche de nous, dans le temps, les cas d’école de la Chine et de Singapour ont prouvé le lien étroit entre la qualité de l’école et le niveau de vie des populations. En Chine, l’ère Deng Xiaoping a été marquée par la modernisation et l’émergence d’une gestion capitaliste. La modernisation de l’enseignement a mis l’accent sur la formation d’une main-d’œuvre pour l’économie de marché : développement des écoles professionnelles, enseignement supérieur répondant aux besoins de l’industrie.
L’exemple de Singapour est encore plus révélateur et plus instructif. Sous le leadership éclairé et pragmatique du premier ministre Lee Kuan Yew le pays décide de s’assumer pleinement. Libérée de l’influence du gouvernement malais (1965), affranchie de la tutelle de Londres (1959), Singapour réalise des réformes économiques et sociales audacieuses qui en font la «petite Suisse » de l’Asie du Sud-Est. Axée sur un système méritocratique et des objectifs de développement humain, l’éducation a été un puissant catalyseur de la transformation de Singapour en une puissance économique mondiale. Le pays a instauré une éducation obligatoire et de qualité, valorisé la réussite scolaire et développé des programmes innovants. Le système récompense la réussite scolaire, créant ainsi un environnement de motivation. Le pays mise sur des enseignants de qualité, astreints à une évaluation annuelle, promis à l’excellence grâce à la formation continue. Singapour vient régulièrement en tête des classements internationaux, notamment en mathématiques, en sciences et en lecture. Pour atténuer la pression, le système est en constance adaptation, cherchant à réduire l’atmosphère de compétition, tout en visant un développement plus complet des apprenants.
Le modèle éducatif de Singapour, nos politiques doivent s’en inspirer. La performance de nos bouffe-la-craie, leur environnement professionnel, veut-on en payer le prix ?
Abraham Kayoko Doré